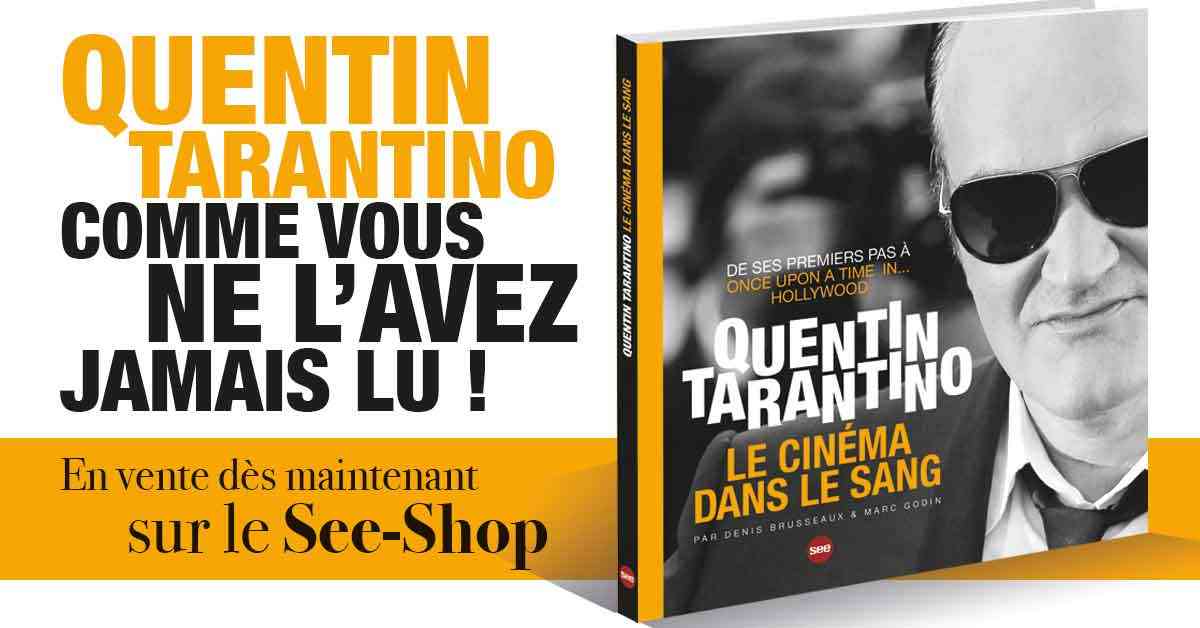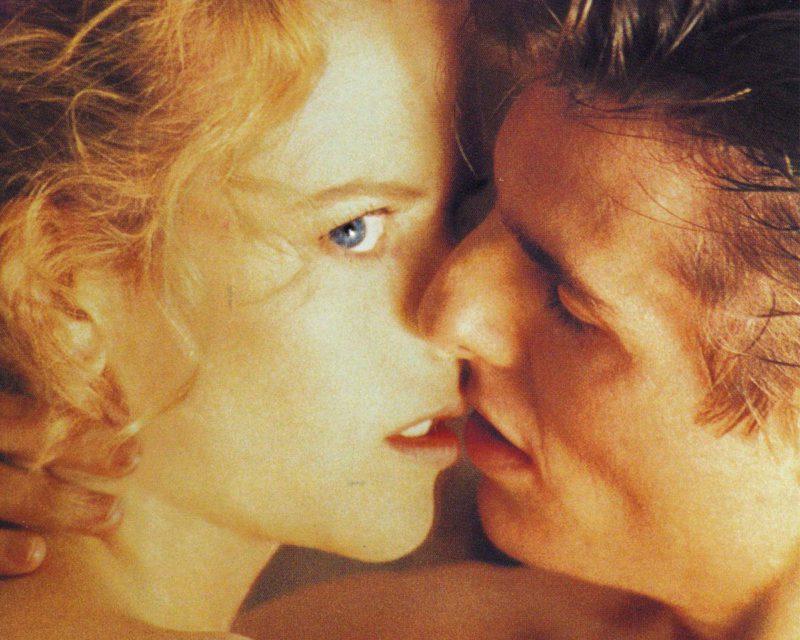Clint Eastwood aura existé grâce à lui, alors rien que pour ça, SEE se devait d’opérer un long retour sur la carrière de Sergio Leone, démolisseur de genre, démiurge accompli, cinéaste légendaire et « imperatore » du western italien
Par Jean-Pascal Grosso
« Tous les gens qui ont fait du fric grâce au western en Italie le doivent à Sergio Leone » assène Fernando Di Leo, co-scénariste de Pour une Poignée de dollars. Pourtant lorsqu’il se frotte pour la première fois au genre, en 1964, Leone, caché sous le pseudonyme plus commercial de Bob Roberston (hommage au pseudonyme choisi par son père, le comédien et cinéaste Roberto Roberti), n’en mène pas large : le film, pompé sur Yojimbo d’Akira Kurosawa, a été péniblement tourné à Almeria, au fin fond de l’Espagne, avec dans la peau du personnage principal – le désormais mythique « Homme sans nom »- un acteur jusque-là très lisse de série télé américaine, Clint Eastwood.
« Quelle nullité ! » note au moment de la sortie française de Pour une poignée de dollars, un critique du magazine Positif.

sergio leone à droite, et lamberto maggiorani, sur le tournage d’Un voleur de bicyclette de vittorio de sica – 1948 © fondazione cineteca di bologna
Pour une poignée de dollars sera projeté au départ dans une seule salle en Italie, la plus pourrie de Florence, et, grâce à un bouche à oreille miraculeux, rapportera des milliards de lires à travers toute l’Europe. « Quelle nullité ! » note pourtant, au moment de sa sortie française, un critique du magazine Positif. Suivront Pour quelques dollars de plus (1965), Le Bon, la brute et le truand (1966), qui clôt la fameuse « trilogie du dollar », le dantesque Il était une fois dans l’Ouest (1968), puis Il était une fois la Révolution (1971), séditieux, éblouissant.
Alors qu’est-ce qui fait, encore aujourd’hui, la différence ? Les intellectuels ont parlé de « cinéma cinéma » chez Leone, c’est à dire de tout un bric-à-brac vernaculaire (la commedia dell’Arte, les Puparri, théâtre de marionnettes siciliennes, l’opéra baroque tout comme les fumetti, les bandes dessinées nationales) que le futur maestro, officiant jusqu’alors sur des péplums en vogue (Quo Vadis, Les Derniers jours de Pompéi…) à Cinécitta, injectera à un genre pré-existant en passe d’être moribond.
« Foutons en l’air le western américain ! » devient le credo de celui qui n’a réellement découvert les Etats-Unis qu’en 1963. Il a 34 ans et son passage à New York est désastreux : « Une société pervertie par l’argent et protégée contre elle-même par ces deux variétés de nuisibles : les avocats et les psychanalystes. »

claudia cardinale dans il était une fois dans l’ouest de sergio leone – 1968 © fondazione cineteca di bologna/fondo angelo novi
De De Sica à Bardot
« Sergio Leone, le genre tyran. Un jour, après avoir fait chier Henry Fonda durant des heures, il lui a demandé comment il faisait pour être aussi docile. Fonda lui a répondu : « Être pro, c’est faire tout ce qu’on vous demande, même si c’est un con qui vous le demande. » » L’anecdote est de feu le chanteur et comédien Serge Reggiani (Casque d’or, Le Doulos…). Leone, c’est un univers en soi, un caractère en soi. Un géant, un ogre parfois. « Vous savez, il était romain. Il racontait pas mal de conneries » lâche son inamovible comparse Ennio Morricone.
C’est Leone qui souffle au réalisateur, pour le rôle d’une esclave, le nom d’une magnifique jeune femme qu’il a croisée en bas de l’immeuble d’un ami agent de comédiens. L’inconnue s’appelle… Brigitte Bardot.
A la fin de la Seconde guerre mondiale, dans une Italie qui, violemment, lave son linge sale fasciste en famille (« Le fascisme une connerie que les Italiens ont prise au sérieux » tranche net le maître), Leone met ses pas dans les pas de son père. Ou plus précisément dans ceux de son parrain, le metteur en scène Mario Camerini dont il devient l’assistant à peine sorti de l’adolescence : « Je considérais cela comme une besogne alimentaire. »
Il œuvre également, sans toujours être payé, sur Le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica, un des films-piliers du néo-réalisme, ou encore Fabiola d’Alessandro Blassetti.
Pour la petite histoire, en 1956, travaillant aux côtés de Robert Wise sur Hélène de Troie, à cette heure florissante du péplum où Cinécitta devient point culminant de tous les intérêts, talents et convoitises, c’est lui qui souffle au réalisateur, pour le rôle d’une esclave, le nom d’une magnifique jeune femme qu’il a croisée en bas de l’immeuble d’un ami agent de comédiens. L’inconnue s’appelle… Brigitte Bardot.

lee van cleef dans le bon, la brute et le truand de sergio leone – 1966 © fondazione cineteca di bologna
Premiers pas derrière la caméra
« Je m’appelle Sergio Leone et je réalise des films toujours trop longs et qui sont toujours coupés. » Ainsi se présentait-il, l’œil malicieux derrière ses éternelles lunettes rondes, une fois venue la consécration. Repéré par William Wyler pour sa maîtrise des foules de figurants sur l’épique Ben Hur (1959), Sergio Leone hérite l’année suivante du scénario écrit à douze mains – dont celles de Duccio Tessari (Un Pistolet pour Ringo, l’excellent Les Grands Fusils avec Delon…) – du Colosse de Rhodes, un péplum avec Rory Calhoun et Léa Massari, exfiltrée pour l’occasion d’un cinéma plus auteurisant.
Pour la scène finale, il met à moitié le feu aux studios de Cinécitta. D’après le comédien Michel Creton, qui doublera Robert de Niro sur Il était une fois en Amérique, un figurant, « aux poils grillés comme ceux d’un poulet en broche », s’enfuira du plateau non sans avoir lancé un magistral bras d’honneur au metteur en scène. Leone ne revient que quatre ans plus tard à la réalisation. Avec un sujet bancal, fauché : Pour une poignée de dollars. En gros, Goldoni + Kurosawa + des cowboys.
Lui qui rêve de Paul Newman se retrouve, faute de moyens, avec un échalas de la télévision américaine ; Clint Eastwood donc. Il le trouve trop propre.
Lui qui rêve de Paul Newman se retrouve, faute de moyens, avec un échalas de la télévision américaine ; Clint Eastwood donc. Il le trouve trop propre. « J’ai acheté un vieux poncho et deux paires de Levi’s noirs que j’ai trempées dans de l’eau de javel » se souvient l’immense Clint pour la préparation du personnage. Le réalisateur insiste pour qu’il cultive une déplaisante barbe de trois jours et lui impose, alors que l’acteur, à l’hygiène irréprochable, ne fume pas, de machouiller en permanence de très acres cigarillos canariens. Le reste appartient à la légende. Il devient d’office le maître du « western spaghetti », au passage, explique-t-il en grand amateur de langage fleuri, « le terme le plus con jamais entendu. »

jennifer connelly et sergio leone sur le tournage d‘il était une fois en amérique – 1984 © fondazione cineteca di bologna
Destructeur de mythes
C’est l’enterrement en grande pompe d’un genre sacralisé. Son pape, John Ford, avait déjà donné l’extrême onction avec L’Homme qui tua Liberty Valance en 1962. John Wayne, icône définitive, y cassait sa pipe, clochardisé, tandis que Jimmy Stewart, en snob bostonien, ramassait les lauriers d’un duel apocryphe face à Lee Marvin en salaud intégral.
A Sergio Leone ensuite de sonner la charge ultime : plus de héros impavide (« Dans l’Ouest, le redresseur de torts irréprochable n’existait pas plus que le chef de bande sans scrupules ou l’indien révolté. »), plus de cheval roué (« Cet animal idiot, un des plus bêtes de la création, on a voulu faire un compagnon attentif et malicieux. ») et, surtout, plus de femme (« Dans le désert, le problème essentiel, c’est de survivre. Et la femme est un obstacle à la survie. ») ! Cynique, Leone ?
Lorsqu’il sort de la projection du Bon, la brute et le truand, Anthony Mann, réalisateur émérite de Winchester 73, est effondré : « Ce n’est pas possible ! Le gentil est en noir et le méchant est en blanc ! »
« Mon père était socialiste, ce qui a fait de moi un socialiste désabusé, et cette désillusion se retrouve dans mes films. » Lorsqu’il sort de la projection du Bon, la brute et le truand, Anthony Mann, réalisateur émérite de Winchester 73, est effondré : « Ce n’est pas possible ! Le gentil est en noir et le méchant est en blanc ! » Brouillage des pistes, inversion des valeurs, fin d’un idéal étoilé, positiviste et rassurant… Sergio Leone est arrivé à ses fins en redonnant à un genre exsangue outre-atlantique ses lettres de noblesses européennes – donc clairement contre-natures.
« Quand on voit que des westerns sont faits, même dans des pays qui n’ont rien à faire avec l’Amérique, comme l’Italie, alors on comprend que l’on se trouve dans une mythologie assez peu éloignée de celles des chevaliers qui faisaient rêver Don Quichotte » note, sagace, Alberto Moravia, l’auteur du Mépris. « Et je devais constater qu’Il Etait une fois dans l’Ouest marquait en vérité le commencement d’un nouveau cinéma : Orange mécanique, par exemple, n’aurait pas été tourné ou autrement. Et même Sam Peckinpah aurait hésité à répandre tant de sang. »
Aidez SEE à rester gratuit, sans pub et indépendant.
Tous nos T-shirts COMICS à partir de 13 euros
Découvrez les t-shirts BY SEECe n’est pas une réplique du Fanfaron de Dino Risi mais bien Leone qui le dit et il a en grande partie raison. Le démiurge a dynamité le western à un point tel que même Hollywood les tourne désormais à sa manière (Les Cent Fusils, Shalako, Joe Kidd…). Ironie du sort, c’est de l’Italie même que viendra la chute. Usé jusqu’à la corde, le « spaghetti » sombrera dans l’ultra-violence éhontée ou la comédie lourdingue, la baffe « terencehillienne » distribuée ad nauseam : « En fait, Trinita était l’aboutissement logique de centaines de westerns insupportables de crétinerie…. On m’avait désigné comme le père du genre. Je n’avais que des enfants tarés. Et aucun ne pouvait être légitime. »
Pour l’éternité
L’ère post-Star Wars a cloué d’un coup au musée pas mal des maîtres du cinéma mondial. Sergio Leone – transcendé par son alliance limite méphistophélique avec Ennio Morricone – n’a, au contraire, pas pris de plomb dans l’aile. Adulé, copié, égratigné aussi (« C’était une personne vulgaire, inculte et pingre, mais touchée par la grâce du cinéma » confesse au passage Luciano Vincenzoni, un de ses scénaristes attitrés), le léviathan romain a depuis rejoint une Almeria éternelle.
Avec Il était une fois en Amérique, celui qui avait refusé la mise en scène du Parrain livre, une monumentale fresque mafieuse à 30 millions de dollars – un chiffre record pour 1984.
Sur terre, le culte, lui, n’a fait que s’amplifier. Non seulement grâce à la « trilogie du dollar » mais aussi, ne surtout pas les oublier, des œuvres par le fond plus ambitieuses : la mise en pièce lyrique de l’idéalisme politique avec Il était une fois la révolution puis, douze longues années plus tard, Il était une fois en Amérique où celui qui avait refusé la mise en scène du Parrain livre, chef d’orchestre d’une jeune génération d’acteurs (De Niro, Woods, Pesci…), une monumentale fresque mafieuse à 30 millions de dollars – un chiffre record pour 1984.
« Dénaturé » par un montage pris en main par le producteur Arnon Milchan, le film sera un échec cuisant aux Etats-Unis. Un final cut non désiré qui laissera à toute l’équipe un goût amer, Sergio Leone en tête. Alors qu’il travaille sur l’adaptation du roman Les 900 Jours de Leningrad de Harrison Salisbury, projet soutenu jusque par le gouvernement italien en la personne de Giulio Andreotti, il meurt d’une crise cardiaque le 30 avril 1989.

robert de niro dans il était une fois en amérique de sergio leone – 1984 © fondazione cineteca di bologna
Depuis, son étoile n’a jamais pâli. Plus fort que Fellini, il a finalement réussi à unir dans une admiration commune critiques de cinéma – qui ne furent pas toujours tendres avec lui – et public à travers le monde entier.
Ce maître du film de genre s’est mué, au fil du temps, en celui du cinéma italien tout entier. Avec hommages et références en force de la part de nouvelles vagues de cinéastes reconnaissants. Sur ses tournages, lorsqu’il souhaite un gros plan très rapproché d’un de ses comédiens, Quentin Tarantino demande paraît-il un « Sergio Leone». Ultime canonisation de celui que le philosophe Jean Baudrillard appelait « le premier cinéaste post-moderne ».