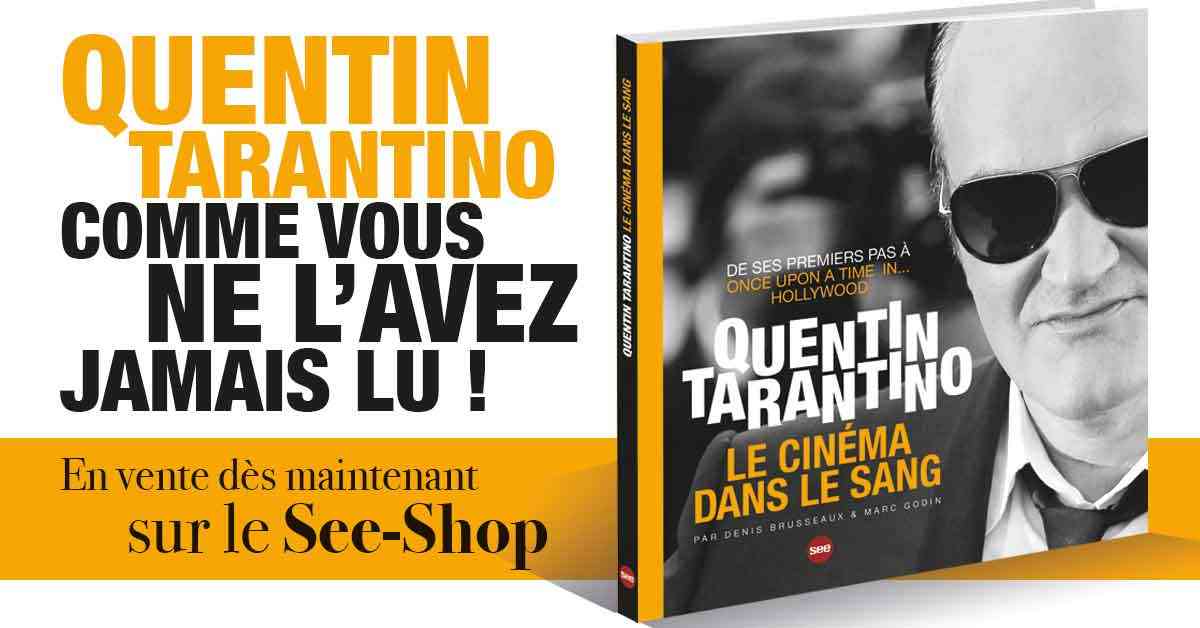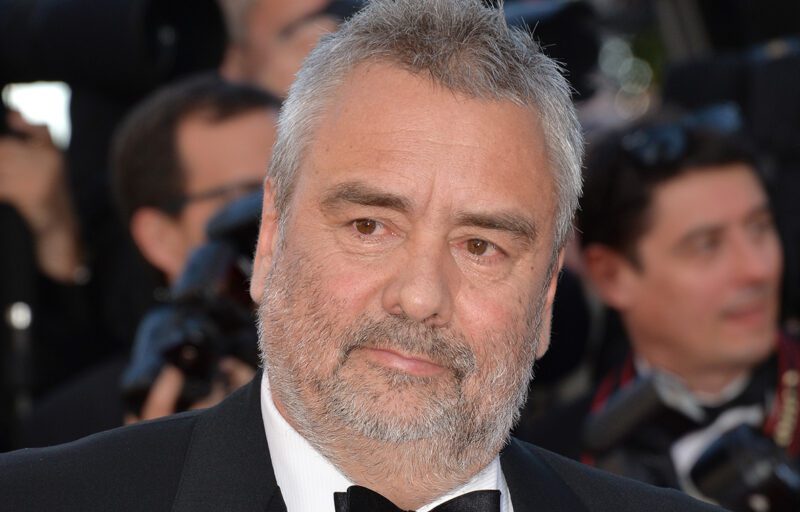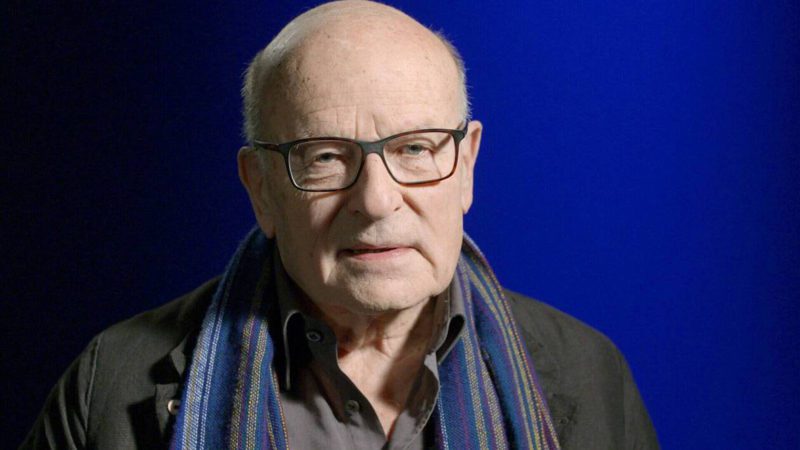Comédienne multicarte, évoluant avec habileté de Louis Garrel à Alain Chabat en passant par Leonardo DiCaprio, en 2018, l’impétueuse Golshifteh Farahani prenait cette fois les armes pour le compte d’Eva Husson (Bang Gang). Dans Les Filles du soleil, elle y campait une combattante kurde. Un rôle-symbole pour cette artiste au parcours atypique.
Propos recueillis par Pierre Blast
Comment Les Filles du soleil est-il venu à vous ?
Pour moi, certains projets, avant même qu’ils ne se concrétisent réellement, avant même que je ne lise le scénario, je sens à quel point ils tombent à pic. J’ai la certitude de devoir les faire. Ce fut le cas avec Les Filles du soleil. Un film sur les femmes yézidis, j’ai su d’office qu’il était fait pour moi.
Comment se prépare-t-on physiquement et psychologiquement à un rôle de femme-soldat ?
Physiquement, nous avions des entraînements militaires. Bizarrement, affreusement même, j’ai vite été très à l’aise avec les armes. Presque trop à mon goût. Je n’ai jamais eu de problème à manier une arme sur un tournage. Ça peut paraître effrayant. On dirait parfois que je suis née avec ! Même avec un arc, je me débrouille pas mal. Nous avons eu également des entraînements plus tactiques, pour les déplacements, les ordres, le commandement des troupes. Et puis, j’ai pris des cours de perfectionnement par rapport à la langue. Quand je joue en langue kurde, je m’exprime uniquement en phonétique. Mais je suis beaucoup plus à l’aise aujourd’hui. Les Filles du soleil est le sixième film dans lequel j’interprète une Kurde alors que c’est une langue que je ne parle absolument pas. Si je m’en sors plutôt bien, ce n’est pas dû au hasard : le premier film que j’ai tourné dans cette langue, j’avais 18 ans, en Iran. Par rapport à la recherche même du personnage ? Je n’ai pas fait grand-chose paradoxalement. C’est comme si Bahar, je l’avais déjà en moi. C’est même la première fois qu’au début d’un tournage je n’ai pas ressenti le moindre trac.
« Ici, on me demandait : « Pourquoi l’héroïne est-elle aussi belle ? » Mais c’est dingue, ça ! Les femmes afghanes comptent parmi les plus belles au monde… »

Golshifteh Farahani avec Leonardo DiCaprio dans Mensonge d’état de Ridley Scott – 2008 © DR
Avez-vous rencontré pour l’occasion des femmes yézidis, des combattantes en lutte contre l’État Islamique ?
Non, mais je savais par où ces femmes étaient passées. Leur personnalité, leur destinée, à mes yeux, cela était clair comme du cristal.
L’accueil du film lors du dernier Festival de Cannes a été assez vif. Quel souvenir en gardez-vous ?
Avec la presse, peut-être. Mais du point de vue du public, pas du tout ! Il a été très chaleureux. La violence de Cannes, c’est lorsque les gens crient leur colère dans la salle ou qu’ils partent en faisant claquer leur strapontin. Tout au long du film, les gens sont restés silencieux et, à la fin, nous avons eu droit à de longs applaudissements. C’était hystérique ! Pour le Jarmusch (Paterson, en sélection officielle en 2016, ndlr), ils furent, par exemple, beaucoup plus nobles. Après, bien sûr, j’ai eu vent des critiques négatives. Mais elles ne m’ont pas étonnée. J’ai l’impression, et spécialement en France, que lorsque vous racontez une histoire « lointaine », qui prend racine dans des endroits difficiles d’accès, on a envie de voir une vérité qui se rapproche du documentaire. Mais dès qu’il y a un regard un temps soit peu cinématographique, là où des gens attendent des choses « moches », c’est la débâcle. Cela m’était déjà arrivé à l’époque de Syngué Sabour. Pierre de patience (un film d’Atiq Rahimi, sorti en 2012, ndlr). Ici, on me demandait : « Pourquoi l’héroïne est-elle aussi belle ? » Mais c’est dingue, ça ! Les femmes afghanes comptent parmi les plus belles au monde…

Golshifteh Farahani dans le prestigieux W Magazine
Dans le documentaire Fifi hurle de joie de Mitra Farahani, sorti en 2013, le peintre iranien en exil Bahman Mohassess tenait des propos particulièrement durs à votre égard. Avez-vous le sentiment d’être toujours mal vue par les Iraniens – y compris par ceux qui ont décidé ou ont été forcés de fuir le régime ?
Je n’ai pas vu le film mais j’ai vu l’extrait dont vous parlez. En fait, sa manière de s’exprimer est très tendre, taquine. Vous savez, comme lorsque vous insultez quelqu’un mais par affection. Cela ne transparaît malheureusement pas dans les sous-titres. Moi, cela ne m’a pas gênée car j’ai tout de suite compris ce qu’il voulait dire : « Ah, la petite conne ! Petite salope que tu es ! » (Rires) Vraiment, avec Mohassess, ce n’était pas le cas. Mais, plus généralement, oui. J’ai été comme le Christ qui a tout pris sur la figure. Je me suis offerte à travers mon art : « Prenez-moi ! » Et, en retour, je me suis fait flinguer. Des insultes, des menaces, sur moi, ma famille. Ce n’était pas facile pour une fille aussi jeune. A l’époque de Mensonges d’état, lorsque je me suis retrouvée à Hollywood, au grand dam de l’Iran, j’avais quoi, 24, 25 ans.
Heureuse, aujourd’hui, en France ?
La France est une terre d’accueil mais les Français ont toujours ce réflexe : « Parlez-nous de votre pays… Que pensez-vous de Téhéran ? » Je m’en fous de Téhéran ! C’est loin pour moi. Mais, ça prend du temps avant d’être considérée comme une femme artiste plutôt que comme une « Iranienne ». Je ne suis pas un porte-drapeau. Je suis où je suis. Et si je dois m’exprimer, c’est par le choix de mes films. Ce que je veux dire, je le dis à travers l’art. Je ne suis pas politicienne. Sinon, j’aurais opté pour une carrière dans un ministère.
« Là, je tourne un film d’auteur français avec Patrick-Pierre Trividic pour enchaîner sur un film d’action aux Etats-Unis, puis ensuite, qui sait, un Marvel, etc. Il y a plein de personnages à l’intérieur de moi. »
Golshifteh Farahani, artiste « révoltée » ?
Je n’accepte pas ce qu’on m’impose. Mais comme n’importe quel être humain. Même lorsque j’ai quitté l’Iran, tout le monde a pensé : « Donnons-lui des rôles de femme du Moyen-Orient ! » Moi, j’ai préféré jouer une Espagnole, une New-yorkaise, une Kurde, une Afghane, une Française, une sorcière… Je refuse d’être cataloguée. Et je n’ai pas l’impression d’appartenir à un groupe. Je suis comme de la paille qui avance au gré du vent. Je m’amuse. Et puis, c’est génial d’avoir le choix. Là, je tourne un film d’auteur français avec Patrick-Pierre Trividic pour enchaîner sur un film d’action aux Etats-Unis, puis ensuite, qui sait, un Marvel, etc. Il y a plein de personnages à l’intérieur de moi. Et je ressens toute la liberté pour les exprimer. J’adore faire ça. Dans ma vie, je ressemble à Mowgli dans Le Livre de la jungle. Je me perds dans les déserts, dans les jungles, à la rencontre de communautés. Puis, je reviens sur les tapis rouges, Cannes, Chanel, coiffée, maquillée. Pour moi, l’un ne peut pas exister sans l’autre. J’ai eu un destin tellement brutal que tout ce qui m’arrive aujourd’hui, je prends ça comme un bonus de vie.
« Un destin tellement brutal ? »
J’ai perdu un pays. J’ai tout perdu. Le prix que je paye est très fort. Je mène une vie très solitaire. Je me retrouve toujours seule dans les hôtels 5 étoiles. De ne pas avoir de famille réellement. Je suis toujours attachée à mon téléphone, à garder le contact avec mes amis, les gens qui me sont proches. Il n’y a personne qui voyage comme moi, qui bouge autant que moi. Et ce n’est pas toujours simple d’assumer seule une vie ainsi.