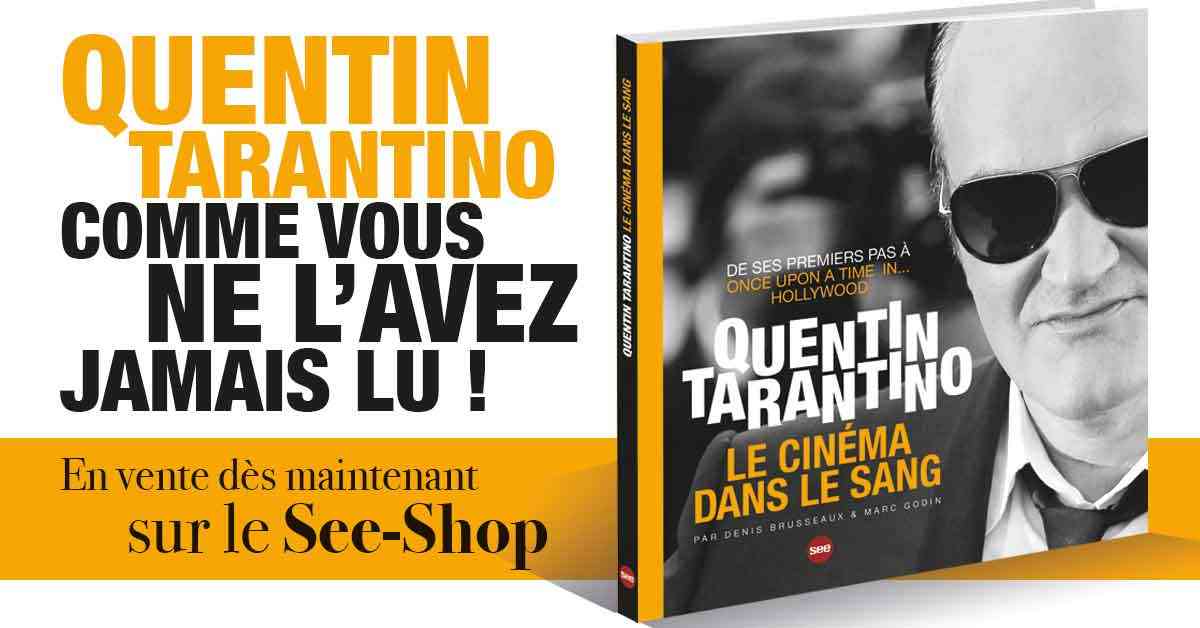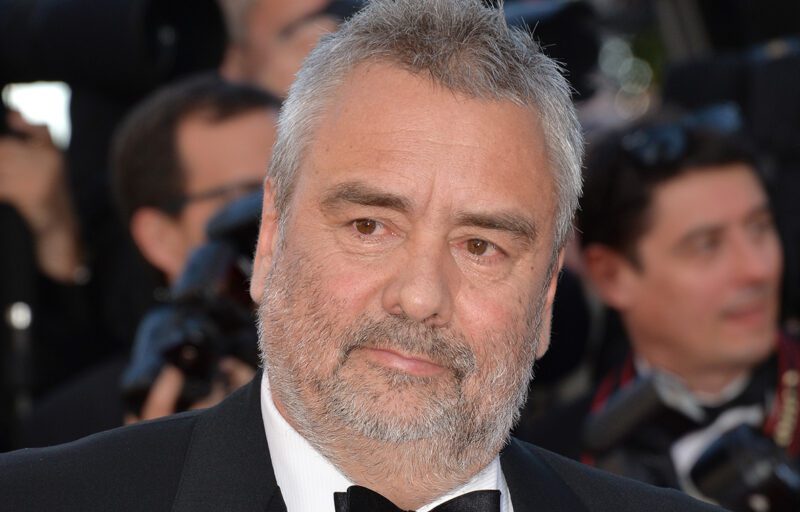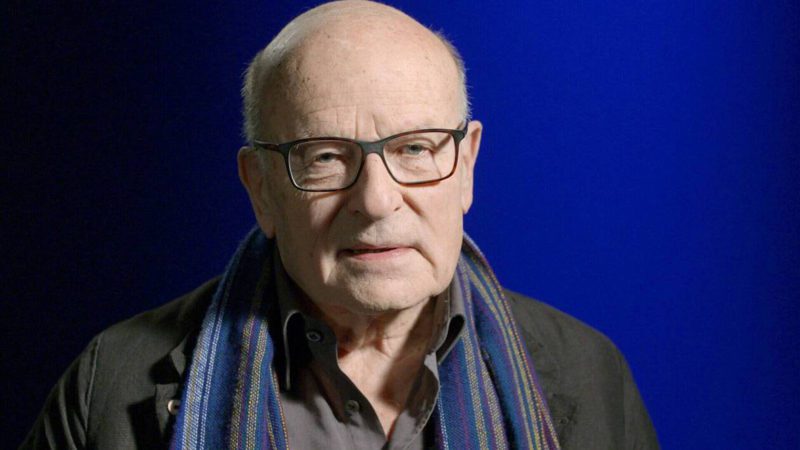© photo de couverture : Andréa Raffin / Shutterstock
Cet été, dans Nevada, il incarnait un taulard qui reprend le goût à la vie en s’occupant de chevaux. Révélé par Bullhead et De Rouille et d’os, Matthias Schoenarts poursuit une carrière sous le signe double d’un charisme à toute épreuve et d’une sensibilité d’artiste à fleur de peau. Confessions.
Propos recueillis par Jean-Pascal Grosso
La promotion d’un long-métrage, est-ce une épreuve pour vous ? Jamais la sensation de vouloir vous libérer d’un projet après des mois de tournage ?
Je ne me suis jamais senti « prisonnier » du film. C’est juste qu’après un certain temps, on se rend compte que finalement on a passé plus de temps à en parler qu’à travailler concrètement dessus. Un décalage assez étrange… Et pendant que vous parlez, vous ne faites rien d’autre du tout ! En même temps, c’est une réalité à laquelle un comédien doit se plier. Je n’aime pas le terme de « vendre » un film. Sinon, je deviendrai « vendeur » et j’aurais horreur de ça. Ce que j’aime, c’est l’idée de défendre une œuvre, surtout quand je suis heureux du résultat.
Que doit incarner un metteur en scène à vos yeux ?
J’ignore si un réalisateur ou une réalisatrice « doit » incarner quelque chose. Un coach, peut-être ? Je ne sais pas. Probablement quelqu’un qui vous nourrit de la bonne manière pour ensuite vous amener à l’inspiration et créer ainsi une émulation. Je pense que c’est comme cela que se provoque la mécanique. Ce n’est pas juste une question de direction. Il faut que le réalisateur soit aussi en demande de propositions, d’improvisations, qu’il vous laisse une certaine liberté…
« Ce que je trouve étrange (…), c’est que De Rouille et d’os n’ait rien obtenu du tout à Cannes. Ça frisait le ridicule… »
Certaines rumeurs laissent à penser qu’en 2012, à Cannes, le Prix d’interprétation pour De rouille et d’os vous est passé sous le nez parce que vous étiez jugé encore trop « jeune »…
Je ne crois pas. Mads Mikkelsen, qui l’avait obtenu à l’époque (Pour La Chasse de Thomas Vinterberg, ndlr), est un comédien extraordinaire. Il l’a amplement mérité. Les récompenses, ce n’est jamais une question d’âge. Ce que je trouve étrange – et je le dis franchement, parce que les prix, même si c’est amusant, ce n’est pas ce qui me fait bouger -, c’est que De Rouille et d’os n’ait rien obtenu du tout à Cannes. Ça frisait le ridicule…
Est-ce vrai que vous avez refusé le remake de RoboCop signé du brésilien José Padilha ?
En partie, même si ensuite l’histoire a été gonflée dans des proportions ahurissantes. Il y avait de la part du réalisateur un intérêt très concret en vue du premier rôle. Nous nous sommes rencontrés deux fois. C’était très chouette, mais, pour moi, ça ne me paraissait pas être le bon moment. Il fallait encore que je travaille un peu avant de me lancer dans de pareils projets. Un film qui ferait le lien. Tout était trop grand, démesuré presque. Les risques, eux, très nombreux. En plus, le scénario que j’avais lu n’était même pas terminé…
Padilha est un réalisateur très particulier. Vous avez vu Troupe d’élite ? Son travail est toujours basé sur une remise en question de l’autorité. Il a débuté sa carrière de réalisateur avec documentaire incroyable sur une prise d’otage dans un bus au Brésil. Ça parlait en même temps de pauvreté, d’injustice, des flics, de la vie dans les favelas… Il avait une vision un peu identique pour son RoboCop. Mais avec un budget de 100 millions de dollars, je me suis demandé si les studios n’allaient pas au bout du compte lui prendre son film des mains et le refaire à leur sauce. Ça pouvait partir tous azimuts. Quand je lui demandais s’il avait le final cut, il devenait vite évasif…
Je suis en train de donner toute une explication, mais en fait, ce projet, je ne le sentais pas, c’est tout. Et quand on ne sent pas, il ne faut pas le faire.
« Pour être vraiment honnête, je n’ai jamais agi par ambition mais par pure envie. »
Ne vous sentez-vous pas trop isolé lorsque vous partez tourner à Hollywood ?
Non. Mon meilleur pote habite là-bas en plus. C’est un super point de repère. Je le vois à chaque fois que je vais à Los Angeles. Il connaît les meilleurs coins. Je me sens très à l’aise là-bas, malgré les contradictions de l’Amérique. Je suis toujours frappé par la pauvreté extrême que je peux y croiser, même dans une ville comme Los Angeles. J’en viens à me demander comment cela doit être au cœur de l’Amérique profonde. Certainement terrible…
Comment votre ADN belge s’exprime-t-il à l’étranger ?
Aucune idée. Je ne sais même pas ce que cela veut dire « se sentir belge ». Je suis né en Belgique, c’est un pays que j’aime. Mais je ne sais pas m’identifier en tant que Belge face à un Français, un Américain… Je ne vois pas trop la différence. Je ne saurais pas répondre à cette question.
Êtes-vous un ambitieux ?
Pour être vraiment honnête, je n’ai jamais agi par ambition mais par pure envie. C’est autre chose pour moi. Une ambition, ça ressemble à quelque chose qu’on pourchasse, qu’on essaye d’atteindre. Je n’ai jamais ressenti ça. J’ai eu envie de travailler sur de beaux projets, avec de bons réalisateurs ; ça oui. Et les choses se sont passées de manière naturelle… Je ne crois pas en l’idée de forcer quoi que ce soit. C’est la meilleure façon de reculer. Pour l’instant, je suis très content. Après on verra…
Le vrai tournant de votre carrière a été Bullhead de Michael R. Roskam…
Oui, le catalyseur de tout. C’est grâce à ce film que j’ai été connu à l’étranger, que j’ai été appelé pour le casting du film de Jacques Audiard, que je me suis retrouvé à Hollywood…
« La pression de la notoriété n’existe pas vraiment. Il faut ne pas trop prendre ça au sérieux ; être plutôt comme un surfeur : monter sur la vague, ne pas se prendre la tête, s’amuser et une fois que tout est terminé, sortir de l’eau et se dire qu’on s’est bien marré. »
Comment vivez-vous la notoriété ?
Il faut surtout faire en sorte pour que cela ne devienne pas une pression. Ce dont vous parlez reste assez abstrait. Je veux dire que la pression de la notoriété n’existe pas vraiment. Il faut ne pas trop prendre ça au sérieux ; être plutôt comme un surfeur : monter sur la vague, ne pas se prendre la tête, s’amuser et une fois que tout est terminé, sortir de l’eau et se dire qu’on s’est bien marré. Et le jour d’après, une autre vague, ça recommence…
Jamais de lassitude parfois ?
Un an et demi avant Bullhead, je n’avais plus envie de faire quoi que ce soit. J’étais vidé. Quand Michael m’a appelé avec une date précise de début de tournage, je me suis dit que je ne me travaillerai plus que sur ce film. Rien d’autre. Si jamais Bullhead, au final, ne me plaisait pas, alors je mettais fin direct à ma carrière d’acteur. Terminé. Sinon, je me serais senti trop misérable, trop malheureux pour le restant de ma vie…
« Je ne veux pas être emphatique dans mes convictions ; je ne me vois pas battre les gens avec un bâton pour leurs mauvaises opinions. »
C’était donc de la frustration plus qu’autre chose…
J’avais tourné d’assez beaux projets mais qui jusque-là ne m’avaient pas donné l’occasion de me lancer à fond. D’où ce sentiment de frustration que j’avais jusqu’à un certain point. Il y avait toujours un truc qui m’emmerdait. C’était « chouette », mais j’avais faim de plus. Je voulais un rôle qui me dévore. En travaillant sur le scénario de Bullhead avec Michael, je savais que cette histoire avait quelque chose de différent. Instinctivement, je me disais que de ce film pouvait venir le bouleversement dont j’avais besoin dans ma vie. Là, je me suis vraiment rendu compte que le cinéma pouvait faire naître des sentiments particulièrement intenses.
Matthias Schoenarts, acteur « politique » ?
Bien sûr que je suis politique. Tout ce que fait l’être humain est politique. Alors, oui, quand je fais un film, c’est politique. Je ne veux pas être emphatique dans mes convictions ; je ne me vois pas battre les gens avec un bâton pour leurs mauvaises opinions. Je préfère jouer dans des films qui délivrent des messages plus implicites. Ce n’est pas trop dans ma nature de trop exposer mes idées. J’essaye de faire ça à ma façon.
Des influences en tant qu’artiste ?
Elles sont nombreuses. Elles peuvent être du côté de l’architecture, du graphisme, de peintres célèbres (Jackson Pollock, Francis Bacon, Basquiat…) ou, à moindre mesure, des films. L’inspiration est partout.
Si vous n’aviez pas embrassé la carrière d’acteur, seriez-vous devenu vous-même peintre ?
J’aurais fait un métier artistique, c’est certain. Dès petit, j’ai dessiné, peint, j’ai fait de la photographie, du théâtre en classe secondaire. J’ai même fait des études de cinéma mais ils m’ont foutu à la porte !
Aidez SEE à rester gratuit, sans pub et indépendant.
Tous nos T-shirts GEEK à partir de 13 euros
Découvrez les t-shirts BY SEE