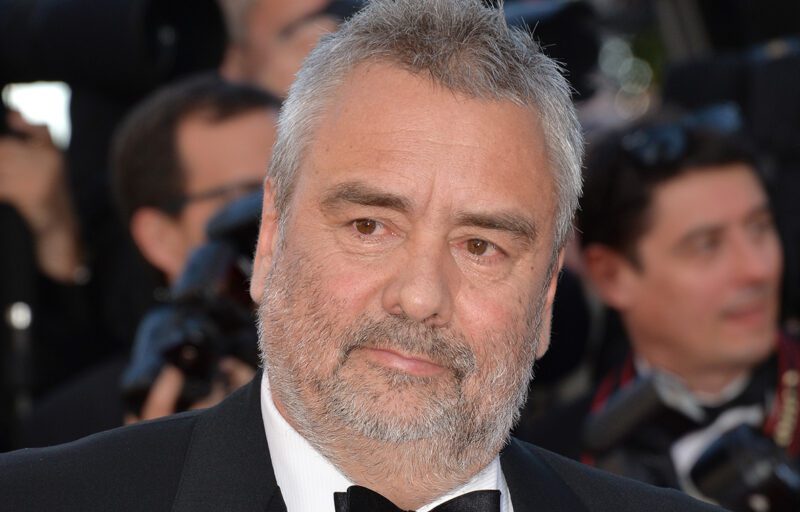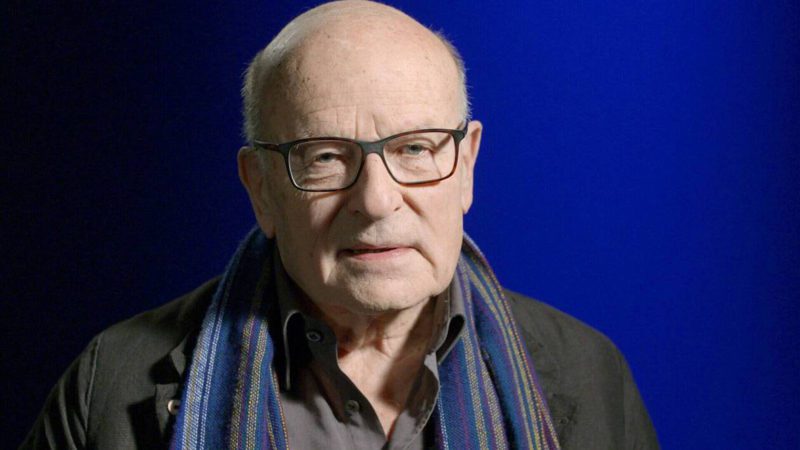L’acteur de Fight Club, L’Incroyable Hulk et Birdman (re)passe à la mise en scène avec Brooklyn Affairs adapté d’un roman noir signé Jonathan Lethem. Edward Norton, 50 ans, parle syndrome de la Tourette, pressions du box-office et réalisation. Rien que pour SEE !
Propos recueillis par Jean-Pascal Grosso
Après Au nom d’Anna, en 2000, vous revenez réalisation avec Brooklyn Affairs. Quel intérêt trouvez-vous à mettre en scène une fiction ?
Un film, ce n’est pas un documentaire. Un documentaire, c’est fait pour éduquer. Un film doit avant tout pouvoir vous séduire. La photographie, la musique, les personnages, les acteurs… Il doit vous entraîner dans le plaisir pur de la fiction, de ce qui est en train d’arriver à l’écran. Et permettre de vous y perdre. De dériver, avec bonheur, dans un univers particulier. Dans le cas contraire, vous vous mettez à trop réfléchir. Et une fiction n’est pas, à première vue, faite pour cela.
En lisant le synopsis, un privé atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, on pouvait risquer de s’attendre à des dialogues plus « trashs » de la part de votre personnage…
Oui, il y a ce cliché sur les personnes atteintes de ce syndrome qui prononcent des choses très vulgaires. Mais, en réalité, c’est un pourcentage très faible des personnes touchées. Les gens qui souffrent de La Tourette à un tel degré, à une telle extrémité, c’est vraiment infime. Là, évidemment, le film se serait retrouvé interdit aux moins de 18 ans. Mais ce n’est pas le cas, ni dans le roman. Je crois que moins de la moitié des patients prononce, en général, même un seul mot. C’est plutôt comme un pincement, une crispation physique.
Pour la préparation du film, j’ai rencontré une femme qui cliquait soudain des yeux et criait le mot « biscuits » en plein milieu d’une phrase. Elle m’a expliqué que c’était le mot qu’elle employait depuis des années et qu’avant cela il y avait eu un autre mot. C’est un syndrome très étrange, inexpliqué, jamais identique chez les personnes touchées. Dans un documentaire, j’ai vu aussi un homme qui, systématiquement, posait sa main droite sur l’épaule des personnes avec lesquelles il entrait en contact. J’ai repris un peu de chaque élément pour composer le personnage. Il fallait créer une balance entre le vocal, le physique et le compulsif.
« J’aime toujours me rendre dans une salle. Me retrouver au milieu d’une foule pour voir un film. »
Êtes-vous satisfait de ce que vous voyez à l’écran aujourd’hui ?
J’aime toujours me rendre dans une salle. Me retrouver au milieu d’une foule pour voir un film. Mais, pour être sincère, non. Cela devient difficile d’être comblé au cinéma. Quelle que soit votre opinion sur les films à gros budget, il y a un tel afflux sur les écrans, qu’il ne reste plus vraiment de temps pour les autres productions. C’est pour cela que c’est un vrai défi de faire, aux Etats-Unis, un film comme Brooklyn Affairs.
L’idée qu’il faille rester un mois à l’écran pour qu’un public adulte puisse prendre le temps de venir voir votre création, c’est terminé. Cela fait partie du passé et ça a fini par empoisonner toute un système. Si vous ne rentrez pas dans vos comptes les deux ou trois premières semaines, c’est fini pour vous. C’est tout ce que vous obtiendrez. Si je vous parle du Privé de Robert Altman ou d’Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ces films restaient plus de six mois sur les écrans. Apocalypse Now avait même tenu 16 mois dans certaines grandes villes américaines ! Une longévité pareille, aujourd’hui, c’est tout bonnement devenu impossible. 16 semaines, c’est un record absolu.
Se mettre en scène au cinéma, vrai plaisir ou grande difficulté ?
Ni vraiment l’un, ni l’autre. Une partie de votre travail d’acteur et du plaisir que vous pouvez en tirer est gâché par la mise en scène et tout ce qu’elle implique et qui occupe votre esprit. Et le plaisir de diriger, de juste rester en retrait, dans l’observation, est entamé du fait que vous devez participer à l’action. Je ne parlerai pas de plaisir, mais plutôt d’efficacité. Quand vous avez compris la manière dont vous devez vous positionner dans chacun de vos rôles, comment les deux parties doivent s’intégrer l’une à l’autre, alors cela devient une expérience très puissante.
« Fight Club n’a remporté aucun prix. Mais il vous sera difficile de trouver un autre film qui, à la même époque, aura eu un tel impact sur sa génération. »
Difficile de monter un film comme Brooklyn Affairs ?
Sincèrement, je suis du bon côté du manche. Je vis de mon art. Est-ce que j’ai eu à lutter pour monter Brooklyn Affairs ? Pendant que je préparais le film, j’ai eu le temps de jouer dans Birdman et The Grand Budapest Hotel. Ce n’est pas lutter, c’est avoir une vie heureuse. J’ai eu beaucoup de chance, le film a pu se faire. A moi aussi d’être reconnaissant. J’espère que le public l’appréciera. Et qu’il le trouvera, par les sujets abordés, même un peu provocateur.
Fight Club a vingt ans. Bien après la polémique, qu’est-ce qu’il en reste à vos yeux ?
Fight Club est un conte d’apprentissage. Un conte de la maturité. Bien sûr, il y a le côté sexy de la rébellion. Mais, ensuite, on grandit et on passe à autre chose… Sur un plan plus personnel, le souvenir le plus impressionnant qui m’en reste est d’avoir réalisé que la reconnaissance prend du temps. C’est là que vous comprenez que le box-office ne mesure en rien le mérite artistique d’une œuvre. J’ai fait l’expérience d’un film qui, sur le coup, ne remporte aucun succès mais, au fur et à mesure, va prendre une place prépondérante dans la culture populaire et dans la vie des gens.
C’est très gratifiant d’arriver à se détacher de la réalité des chiffres, qui finalement ne veulent rien dire, de l’absence de récompense. Fight Club n’a remporté aucun prix. Mais il vous sera difficile de trouver un autre film qui, à la même époque, aura eu un tel impact sur sa génération. Et il n’a pas démérité depuis. En 1999, il y a eu Fight Club, Matrix, Magnolia, Dans la peau de John Malkovich… Fincher, les Wachowski, Paul Thomas Anderson, Spike Jonze… Ce fut une très grande année pour le cinéma américain. Une nouvelle génération apparaissait. Et aucun de ces films n’a eu l’Oscar du meilleur film. Le meilleur film de l’année, vous en rappelez-vous ? American Beauty de Sam Mendes. Fight Club était, lui, bien trop dans la contre-culture.