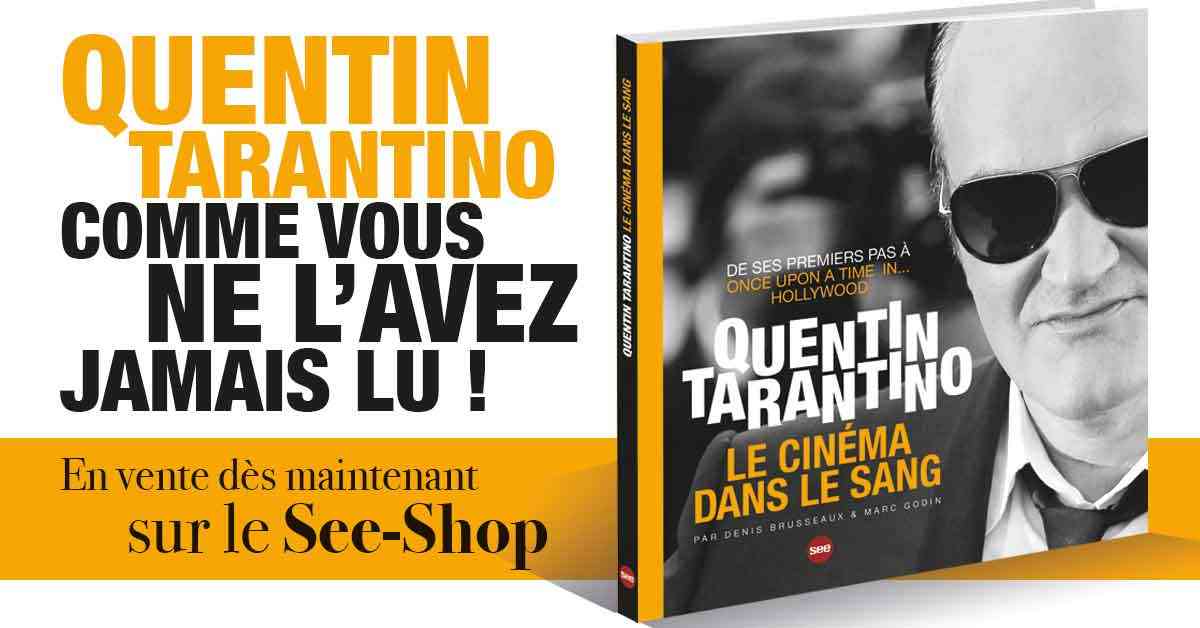Django Unchained





Par Denis Brusseaux
Quentin Tarantino est à la fois un cinéphile « hardcore » et un brillant dramaturge, et chez lui ces deux facettes sont indissociables. Elles se répondent et se complètent, forçant le spectateur à abandonner toute idée préconçue. Les premières secondes de Django Unchained sont, à ce titre, exemplaires.
A peine le logo de la Weinstein Company a-t-il disparu que la chanson écrite par Luis Bacalov pour le Django de Sergio Corbucci (1966) résonne à nos oreilles. On ne peut pas faire plus évident : Django Unchained s’ouvre sur le thème musical d’un autre Django, lui-même œuvre séminale du western spaghetti. A cet instant précis, alors que les lumières de la salle viennent de s’éteindre, Tarantino nous plonge en pleine expérience citationnelle, la plus littérale de toute sa carrière. Mais presqu’aussitôt, on réalise que cette chanson est employée quasiment à contre-emploi. Au lieu d’accompagner la silhouette d’un homme chevauchant à l’horizon (comme il est d’usage dans tout western, qu’il soit européen ou américain), elle accompagne au contraire une sorte d’océan de pierre, une multitude de rochers à perte de vue… L’espace est carrément bouché par des cailloux, image anxiogène, claustrophobe, en contradiction avec l’air triomphal (« Django ! Django ! ») que fredonne Roberto Fia.

Deux souffrances évoquées simultanément
Lentement, la caméra se décale et révèle des hommes noirs enchaînés tels des forçats, et parmi eux le fameux Django (Jamie Foxx). Difficile de faire la connexion entre l’annonce sonore (purement épique) et l’annonce visuelle (pathétique), et pourtant ce lien existe : les paroles de la chanson – si on les écoute attentivement – ne se contentent pas de scander le nom du héros, mais racontent sa solitude extrême, sa douleur d’avoir perdu l’être aimé (« Have you always been alone ? (…) Now, your love has gone away »).
Deux souffrances sont ainsi évoquées simultanément, celle de l’esclavage (à l’image) et celle de l’amour disparu (dans la bande-son). Cette rivalité d’enjeux va aussi devenir celle du film, déchiré entre son désir de traiter un drame à grande échelle (le sort des noirs) et celui de suivre la quête égoïste du personnage principal (à la recherche de sa femme). Etonnant comme, à partir de références au 7ème art, Tarantino pose d’emblée les bases d’un film totalement personnel, jusque dans sa prise de distance radicale avec l’œuvre sur laquelle il semblait s’appuyer. Celui-ci, qui met en scène un héros blanc APRES la guerre des Sécession, est définitivement déconnecté du projet…

Renverser les codes et les repères du public
L’action se déroule dans le Sud des Etats-Unis en 1859, soit deux ans avant le début de la Guerre de Sécession. Les prisonniers, dévoilés dans la scène d’ouverture, sont escortés les frères Speck, qui comptent les vendre sur un marché d’esclaves. Mais le petit cortège croise nuitamment la route d’un certain Dr King Schultz (Christoph Waltz) qui, sous couvert de son métier officiel de dentiste, est chasseur de prime. Il rachète Django (la scène est inénarrable), lequel est seul capable de l’aider à identifier trois criminels, les frères Brittle, dont les têtes sont mises à prix. Bien vite, Schultz fait de Django son associé – d’autant que ce dernier s’avère un excellent tireur – et lui met un marché en main : s’il l’aide à traquer divers hors-la-loi durant l’hiver, ils iront ensuite libérer Broomhilda von Shaft, la femme de Django, devenue l’esclave personnelle d’un propriétaire de plantation du Mississipi, le sinistre Calvin Candie (Leonardo DiCaprio)…
Quentin Tarantino aborde ici le western exactement de la même manière qu’il avait envisagé le film de commando dans Inglourious Basterds, c’est-à-dire en s’amusant à renverser les codes et les repères du public. Dans Basterds, il mettait en scène un groupe de juifs américains excédés par les exactions d’Hitler au point d’employer les méthodes de l’ennemi (torture, stratégie de la terreur), jusqu’à nous faire (presque) prendre en pitié les sbires du Führer. Le cinéaste prenait acte de son angle d’attaque, parfaitement contraire à l’Histoire, en réécrivant celle-ci lors des dernières minutes du film.

Le film le plus poignant de Tarantino
Dans Django Unchained, le personnage principal est un noir qui endosse successivement les rôles (au sens théâtral du terme) de chasseur de primes, puis de négrier (!), c’est-à-dire qu’il va au court du film s’enrichir en tuant des blancs puis en achetant d’autres noirs, ce qui est évidemment historiquement improbable. Et si tous les protagonistes trouvent la chose pour le moins surprenante, ils finissent par l’accepter, en grande partie grâce à la force de conviction de King Schultz (l’alter-ego de Tarantino), capable de vendre n’importe quel concept farfelu.
Bien sûr, tout ceci est une stratégie pour sauver la femme de Django, mais il n’empêche que notre héros va réellement assumer ces deux fonctions, notamment lors d’une scène mémorable où il prend la décision d’abandonner un esclave à son sort, contre l’avis de Schultz qui veut le sauver. Il semble que Tarantino ait besoin, en tant qu’auteur, d’infléchir le réel au gré de sa fantaisie, pour mieux s’autoriser à aborder, dans le même temps, des sujets puissants avec une franchise que bien des cinéastes « humanistes » ne s’autoriseront jamais. Dans Django Unchained, le point de départ est le plus « déviant » de sa carrière de cinéaste, ce qui débouche à l’arrivée sur son film le plus poignant. Sacré paradoxe.

Ne plus jouer au chat et la souris avec les enjeux humains
On a beaucoup reproché à Quentin Tarantino de rester à la surface des choses pour se contenter d’expériences purement jouissives, sans fond véritable. Même Inglourious Basterds n’échappait pas tout à fait à cette critique, dans la mesure où ce film sur la Seconde Guerre Mondiale abordait son thème le plus sombre (l’Holocauste) d’une façon assez détournée, en s’en tenant à une double vengeance où l’extermination des juifs d’Europe n’était qu’évoquée, jamais montrée.
Du coup, en dépit de ses immenses qualités, Basterds restait une série B défouloir (on venait voir des nazis se faire éclater à la batte, et on était tout de suite servis) sans portée humaniste. Hitler et sa clique étaient réduits à l’état de pigeons, et tirés comme tels. Trois ans plus tard, Quentin Tarantino a considérablement mûri, et Django Unchained ne joue plus au chat et à la souris avec ses enjeux humains et historiques.
Esclaves ou gladiateurs
Les hommes enchaînées dans le plan d’ouverture nous font entrer de plain-pied dans l’univers du film, que le cinéaste ne quittera plus jusqu’à la fin. Son western est pour l’essentiel un voyage initiatique au pays de l’esclavage, dont il ne cache rien des atrocités, tout en nous dévoilant des détails purement techniques rarement montrés au cinéma, comme ces affreuses muselières équipées de longs crochets. Combats de « mandingues » (des esclaves sont transformés en gladiateurs pour des luttes qui tournent à la boucherie), châtiments corporels et surtout immenses propriétés peuplées de noires et au milieu desquelles trônent quelques blancs, vivant dans un monde entièrement à cette couleur que pourtant ils méprisent…
On sent Tarantino électrisé par son sujet, saisi aux tripes, ce qui le conduit à nous livrer la séquence la moins cynique et la plus viscérale de tout son cinéma, lorsqu’un Django fou furieux se met à fouetter un négrier sous les yeux d’esclaves médusés, et au son d’une musique cathartique. A cet instant, Tarantino se démarque de la loi du Talion froidement calculée de Basterds pour nous submerger d’une violence non contrôlée, non théorique, mais vraiment pulsionnelle, rageuse et désespérée. Chose assez rare, il écoute davantage son cœur que son cerveau.
Et quand nous arrivons dans la plantation de Calvin Candie, Django Unchained monte encore de plusieurs crans. Avec sa description d’un véritable enfer soumis au sadisme d’un maniaque et de son complice, un vieux serviteur noir à l’âme corrompue (incroyable Samuel L. Jackson), Tarantino convoque des images et des idées qui sont aussi bien valables pour dénoncer l’esclavage que pour dépeindre cet Holocauste jamais montré dans Basterds : cruautés mentales et physiques, prisonniers déshumanisés, exécutions sommaires, victime alliée au bourreau…

D’une grande limpidité dramaturgique
Par le style, Django Unchained rompt complètement avec Kill Bill, dont la trame n’était qu’un prétexte pour une ballade au pays de la cinéphilie de Quentin Tarantino, Uma Thurman changeant d’univers filmique à chaque séquence. Même la déconstruction non-chronologique du récit – figure de style incontournable de Reservoir Dogs à Inglourious Basterds – brille ici par son absence. Linéaire en diable, d’une grande limpidité dramaturgique, déroulant ses enjeux selon le programme annoncé dès le premier quart d’heure,
Django Unchained est, sur le plan narratif, le plus classique des films de Tarantino. La mise en scène se met au service des enjeux du personnage au lieu de les désamorcer par des afféteries de style, respectant le cahier des charges du western avec humilité. En sortant de la salle, on pouvait entendre certains spectateurs dire « C’est du Tarantino pur jus ». Vrai et faux. Vrai, car celui qui vient y chercher de l’ultra violence, de l’humour (la scène du Ku Klux Klan), des situations incongrues étirées jusqu’à l’absurde, des prestations d’acteurs inoubliables (Leonardo DiCaprio joue comme s’il avait tout à prouver) et des huis-clos à rallonge où le suspense devient insupportable (une heure en temps réel, dans la plantation), devraient à priori en ressortir plus que ravi. Mais faux, en ce sens que Tarantino, pour la première fois, se sent obligé de raconter l’histoire qu’il a promise à son public, au lieu de jouer à le décevoir pour mieux le surprendre. Alors qu’autrefois il s’amusait à nous frustrer (du braquage de Reservoir Dogs, du duel final de Kill Bill, des batailles d’Inglourious Basterds) en nous adressant de vrais pied-de-nez,
Un John Ford Punk et un Sergio Leone trash
Quentin se met ici dans la peau d’un John Ford (tendance punk) ou d’un Sergio Leone (version trash), et fait sienne leur rigueur de raconteurs d’histoire « grand public ». Les dilemmes du héros, les explosions de violence ou les chevauchées sauvages ne relèvent plus de « l’ironie Tarantinesque », mais du cinéma à l’ancienne. A la clé, il livre son œuvre la plus puissante et la plus divertissante. C’est aussi sous cet angle, celui du premier degré, que l’on peut expliquer certaines des faiblesses du film, quand le cinéaste annonce une épopée qu’il ne tient pas vraiment (les héros sont supposés chasser des hors-la-loi pendant tout l’hiver, mais ce segment ne dure pas plus de cinq minutes), ou bien lorsqu’il s’acharne à nous offrir un grand final dans la tradition, au risque d’allonger son dernier acte jusqu’à la redondance (vingt minutes inutiles à la fin), là où sa sécheresse habituelle aurait, pour le coup, été plus percutante.

« Nigger »
Un contentieux a longtemps opposé Spike Lee et Tarantino au sujet de l’usage plus qu’abondant que ce dernier fait du terme « nigger » (en français familier, ça donne « négro ») dans ses films, mot que ses personnages blancs envoient à la figure de leurs interlocuteurs noirs, mais que les noirs eux-mêmes emploient pour s’adresser les uns aux autres. Enervé, le réalisateur de Malcolm X s’est publiquement révolté contre ce tic de langage qui, selon lui, banalise un vocable raciste, comme s’il devenait à la mode, alors qu’il reste blessant pour beaucoup de gens.
En guise de réplique à Tarantino et à ses excès, Spike Lee a tourné en 2000 une satire de la télévision, The Very Black Show, où un producteur blanc envoie, à un scénariste offusqué : « Je me fous de ce que pense ce con de Spike Lee, c’est Tarantino qui a raison, « nigger » c’est un mot comme un autre ! ». Evidemment Quentin, directement visé, l’aurait très mal pris. Cet incident, rapporté par Peter Biskind dans son livre Sexe, Mensonges et Hollywood, est-il susceptible de se répéter aujourd’hui, compte tenu du fait que « nigger » est prononcé environ 110 fois dans Django Unchained ? C’est possible, d’autant que le regard que porte Tarantino sur l’esclavage, aussi humaniste soit-il, n’en reste pas moins excessif et iconoclaste, et donc critiquable. Mais s’il y a une chose que l’on ne pourra jamais reprocher à Quentin Tarantino, c’est de choisir la facilité.
Brouiller les cartes !
Chez lui, nul manichéisme, encore moins de vision paternaliste. Dans Django Unchained, le héros noir, Django, ne lève jamais le petit doigt pour aider d’autres esclaves, et ne tient jamais de discours révolutionnaire. Sa quête de vengeance et de sauvetage est purement égoïste. A l’opposé, le seul personnage absolument généreux et altruiste, doué de compassion et de remord, est King Schultz, un blanc. Le fait que Tarantino ait fait d’un allemand le premier vrai héros positif de toute son œuvre et qu’il l’ait confié à celui qui campait un S.S. dans Inglourious Basterds indique assez bien avec quel plaisir il brouille les cartes, transformant toute tentative de critique morale de son film en véritable parcours du combattant…
Date de sortie : 16 janvier 2013 – Durée : 2h45 – Réal. : Quentin Tarantino – Avec : Christoph Waltz, Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson… – Genre : western, action – Nationalité : américaine
Deux souffrances évoquées simultanément Lentement, la caméra se décale et révèle des hommes noirs enchaînés tels des forçats, et parmi eux le fameux Django (Jamie Foxx). Difficile de faire la connexion entre l’annonce sonore (purement épique) et l’annonce visuelle (pathétique), et pourtant ce lien existe : les paroles de la chanson – si on les écoute […]